
Rhinocéros blanc du Sud
Fiche Information
Nom scientifique : Ceratotherium simum simum
Classification : Mammifère
Taille moyenne : 3m40 à 4m20 de long, 1m50 à 1m80 au garrot
Poids moyen : 1300kg à 3500kg
Longévité : 40 à 50 ans à l’état sauvage, Environ 30 ans en captivité
Habitat : Savanes, Broussailles, Prairies
Régime Alimentaire : Végétarien principalement herbivore
Comportement social : Femelles en groupes / Mâles solitaires
Période de reproduction : Toute l’année
Maturité sexuelle : Femelles vers 3-5 ans / Mâles vers 5-7 ans
Gestation/Incubation : Environ 1 an et demi, 1 petit par portée
Statut de conservation :
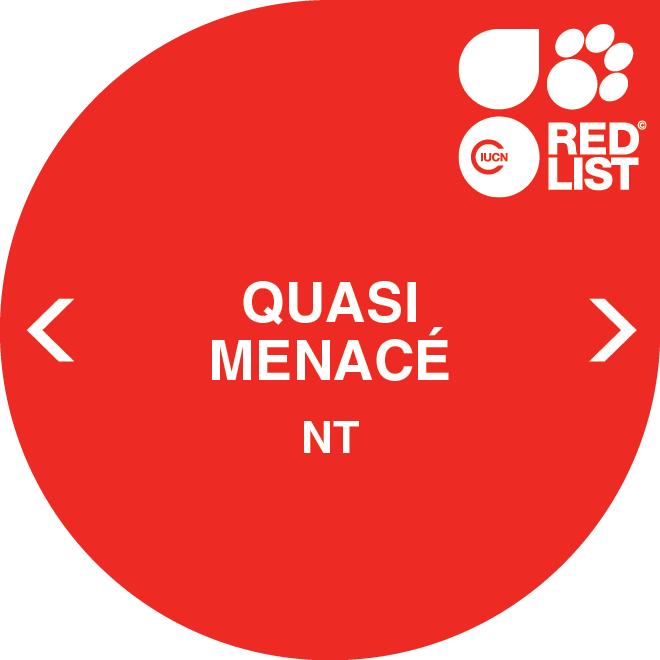
Répartition géographique


Cette espèce participe au programme d’élevage Européen.
Description
Le rhinocéros blanc du Sud est le second plus gros mammifère terrestre après l’éléphant. Cette espèce se distingue de son cousin proche le rhinocéros noir par la forme de ses lèvres larges et plates qui lui permettent de paître et d’arracher efficacement les brins d’herbes, alors que la bouche du rhinocéros noir est plutôt triangulaire avec une lèvre en pointe lui permettant d’attraper plus facilement les feuilles. Contrairement à ce que pourraient laisser penser leurs noms ces deux espèces sont en fait de couleur grise, leurs noms venant d’une erreur de traduction. La peau des rhinocéros est épaisse et dépourvue de poils sauf aux extrémités des oreilles et de la queue. Cette peau nécessite des soins constants : des bains de boue, de terre ou d’eau sont indispensables pour éliminer les cellules mortes et les parasites ainsi que recouvrir le corps d’une pellicule protectrice contre les coups de soleil.
Cette espèce habite les milieux ouverts du sud de l’Afrique. Territoriale, elle délimite son territoire en y déposant des excréments. Les mâles sont plutôt solitaires, alors que les femelles se rassemblent en troupeaux, accompagnées de leurs jeunes. Une femelle gestante proche de son terme s’isole dans une zone de couvert végétal dense pour mettre bas et élever son petit à l’abri durant le premier mois. Celui-ci pèse environ 60 kg à la naissance. Lorsque le jeune atteint l’âge de 2-3 ans, la mère le repousse pour se dédier à une nouvelle gestation. Les jeunes mâles sont sexuellement matures plus tardivement que les femelles, et n’auront l’occasion de se reproduire que lorsqu’ils seront assez forts pour entrer en compétition avec les autres mâles dominants, afin de gagner les faveurs des femelles.
Le rhinocéros blanc a une mauvaise vue. Ses yeux sont petits, et ses grosses cornes au milieu de la face sont un obstacle gênant la vision d’ensemble. Son odorat et son ouïe sont cependant très développés. Il peut orienter ses oreilles dans toutes les directions indépendamment l’une de l’autre. S’il repère un danger, le rhinocéros peut courir à plus de 55 km/h sur de courtes distances, grâce à ses jambes puissantes et ses 3 doigts à chaque patte qui lui confèrent une bonne adhérence dans la boue et le sable. Sa taille imposante le rend tout de même presque invulnérable face aux autres animaux. Seuls les jeunes peuvent être ciblés par le lion ou la hyène tachetée.
L’humain est la principale menace qui pèse sur le rhinocéros blanc. Il est responsable du déclin de cette espèce par la destruction de son habitat et par le braconnage pour sa corne, utilisée en médecine traditionnelle ou pour la fabrication de bijoux et autres décorations. Des projets ont vu le jour pour scier ou colorer les cornes des rhinocéros afin de les protéger, mais en plus d’être un travail fastidieux et délicat à mettre en place, cela peut entraîner des conséquences néfastes sur l’animal, puisque ces cornes sont utilisées pour se défendre et lors des combats entre mâles. Le rhinocéros blanc du Sud est aujourd’hui considéré comme « quasi menacé » par l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). Des mesures de protection variées ont été mises en place, comme l’établissement de parcs nationaux et réserves naturelles surveillées par des rangers, mais aussi des déplacements d’individus depuis des régions où ils sont encore abondants vers des zones dont ils avaient disparu.











